> sortie de la crise picturale
De toute évidence, pour un artiste confronté au défi d'incarner de manière créative le deuxième lustre du XXe siècle, un village aussi reculé, situé au milieu des Pyrénées catalanes, n'était pas, à première vue, le lieu le plus approprié pour chercher une solution à la crise picturale qui l'avait conduit à peindre le portrait de Gertrude Stein. Mais Gósol est rapidement devenu un lieu fertile pour Picasso car, pour la première fois de sa vie, il était plongé dans un style de vie basé sur le courage de la vérité, dans une économie de subsistance et entouré d'un environnement montagneux rude.
Ce « courage de la vérité » (pour reprendre les termes de Foucault)[1] était une vie quotidienne qui transmutait ce qu'il portait en lui, ce qui avait été bloqué par une sorte de langueur sans précédent. Cette langueur, qui l’avait saisi juste avant son premier départ pour Barcelone (où il annonça son arrivée le lundi après le 16 mai, c'est-à-dire le 21 mai)[2] puis ensuite pour Gósol (probablement le vendredi 25 mai),[3] était, à mon avis, la principale raison pour laquelle le Portrait de Gertrude Stein était resté inachevé dans un coin de son atelier du Bateau-Lavoir à Paris.[4] Ce portraitiste doué ne pouvait tout simplement pas revenir à la période rose (dite « période arlequin » ou « période italienne » dans l'histoire de Stein), une époque avec laquelle le Portrait de Gertrude Stein, qui a révolutionné le genre du portrait, représentait une violente rupture. Néanmoins, Picasso ne savait quelle direction prendre. Il était indécis et a éprouvé, pour la première fois, de profonds doutes sur ses méthodes picturales. On peut considérer que son état d'esprit artistique était très proche de celui de Cézanne, et qu'il avait décidé d'expérimenter en profondeur toutes les hésitations et préoccupations de Cézanne.[5]
Je propose donc de dater l'influence de Cézanne sur Picasso plus tôt que la plupart des chercheurs et biographes, y compris Richardson, Daix, ou Cowling,[6] qui datent le premier tournant clair de Picasso vers Cézanne de l'exposition des œuvres de ce dernier au Salon d'Automne de 1906, qui s’ouvrit deux mois et dix jours après le retour de Picasso de Gósol, et seulement quelques semaines avant la mort du maître. Cependant, selon moi, lorsque Picasso demanda à Stein de poser pour lui au début de 1906 (près de cinq mois avant qu'il ne se rende à Gósol), il essayait déjà de ressentir toutes les tensions cézanniennes dans l'abandon du sujet, s'efforçant d'aller sur le motif, précisément la principale maxime créative de Cézanne. En d'autres termes, Picasso essayait de peindre non pas pour représenter, mais pour présenter.[7] Je suppose que c'est la principale raison d'un événement extraordinaire, que Picasso ait demandé à Gertrude Stein de poser pendant de si nombreuses séances.[8]
Ce qui est extraordinaire, selon moi, n’est donc pas tant que Gertrude Stein pose, mais que Picasso lui demande un si grand nombre de séances et échoue. Les ressemblances avec les procédés de Cézanne sont étonnantes. Comme le signale Merleau-Ponty au début de son texte « Le doute de Cézanne », sur le maître d’Aix :
« Il avait besoin d’une centaine de séances de travail pour une nature morte, de cent cinquante séances de pose pour un portrait. » [9]
C'est avec cette obsession « d'aller sur le motif » que Picasso expérimente avec la première série de doutes de Cézanne et abandonne le portrait de la femme, la laissant sans visage. La raison en était, comme il l'a prétendument déclaré, qu'il ne voyait plus Stein quand il la regardait : « Je ne vous vois plus quand je vous regarde ». [10]
[1] Michel Foucault, Le courage de la vérité: Le gouvernement de soi et des autres II: Cours au Collège de France (1983-1984) (Gallimard: Paris, 2009).
[2] Comme on peut le lire dans une lettre de Picasso à Casanovas du 16 mai (mercredi) : « Nous arriverons le lundi après-midi à Barcelone. Je te préviendrai pour qu'on puisse se voir. Un bon coup de poing sur le nez de ton ami Picasso »; Portell i Camps, Les cartes, lettre 29)
[3] Voir Portell i Camps, Les cartes, lettre 30.
[4] Voir Richardson, A life of Picasso, Vol. I, p. 433–54; Pierre Cabanne, Le Siècle de Picasso, Vol. I, La Jeunesse, le cubisme, le théâtre, l’amour, 1881–1937 (Paris: Denoël, 1973), p.180–5 et Elisabeth Cowling, “Le drame de l’homme. Le Cézannisme de Picasso en 1906–1907,” dans Odile Billoret-Bourdy et Michel Guérin (Eds.) catalogue Picasso Cézanne. Quelle filiation ? (Aix–en–Provence: Musée Granet, 2009), p.43–54, en particulier p.45.
[5] Picasso déclara à Christian Zervos en 1935 : « Ce qui nous intéresse, c’est l’inquiétude de Cézanne, c’est l’enseignement de Cézanne » Cahiers d’Art, Nº spécial : p. 173–78, cité dans Bernadac et Michael (Eds.), Picasso, p. 36.
[6] Voir Richardson, A life of Picasso, Vol. II, 47–57; Pierre Daix, Le nouveau Dictionnaire Picasso (Paris: Ed. Robert Laffont, 2012), p. 176–80.
[7] Les critiques mentionnés reconnaissent l'influence de Cézanne sur la résolution du portrait de Stein et surtout l'influence sur Picasso de Madame Cézanne avec éventail (acquis par les Stein en 1904). Cependant, ils n’insistent guère sur le rôle de la période gosolane. C'est également la position de Madelaine, Gertrude Stein, Pablo Picasso, p. 9–11; de Tinterow et Stein (Ed.), Picasso, p. 109–10, ainsi que de Cowling, « Le drame de l’homme », p. 43–54. Pierre Cabanne est celui qui fait le plus clairement allusion à Cézanne lorsqu'il évoque les référents créatifs de Picasso à Gósol, bien qu'il ne développe pas cette idée. Voir : Cabanne, Le Siècle, Vol. I, 180–5.
[8] Voir Stein, Picasso, 510. Voir aussi The Autobiography, p. 713.
[9] Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens (Paris : Gallimard, 1996 [1966]), p. 13–33 (ce texte à la p. 13). « Le doute de Cézanne » a été publié pour la première fois en 1945 dans Fontaine, 47, t. VIII: p. 80-100.
[10] Stein, The Autobiography, p. 713. Il faut noter que le français était la seule langue en commun entre Picasso et Gertrude Stein. Sur ces mots, voir Marie-Laure Bernadac et Androula Michaël (Eds.), Picasso. Propos sur l’art (Paris : Gallimard, 1998), p. 170–2, voir en particulier p. 172, et Antonia Vallentin, Picasso (Paris: Albin Michel, 1957). Voir aussi Richardson, A life of Picasso, Vol. I: p. 410; Lucy Belloli, “The evolution of Picasso’s Portrait of Gertrude Stein,” Burlington Magazine 141 (1999): p. 12–18, et Tinterow et Stein (Ed.), Picasso, p. 114–5.
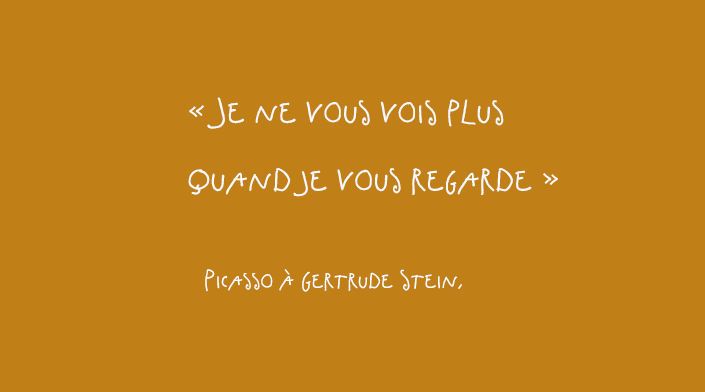




 Sommaire
Sommaire