Trois raisons simultanées pour cette renaissance de Picasso
1906 est l'année au cours de laquelle Picasso a abandonné les procédés du XIXe siècle encore présents dans ses périodes bleu et rose et s'est embarqué dans un voyage vers sa forme particulière de modernité. C’est dans le Portrait de Gertrude Stein qu’il a expérimenté avec cette transformation, comme l'explique son amie proche à l’époque en décrivant sa « longue lutte » à cette époque.[1]
Cette « longue lutte » s'est déroulée pendant l'hiver, le printemps et l'été de 1906, au cours d’un nombre sans précédent de séances de pose[2], qui s'est terminée en mai par la disparition du visage de Stein. Elle s'est poursuivie pendant le voyage de Picasso et Fernande à Gósol, une petite ville catalane située sur le versant sud des Pyrénées. Le retour de Picasso à Paris fin juillet marque, plutôt que la fin d'un voyage, la confirmation d'une renaissance pour l'artiste, qui avait alors complètement adopté sa particulière modernité. L'achèvement rapide et concluant du portrait de Stein a été le premier événement de cette renaissance.
L'objectif de cet article est de proposer trois raisons simultanées pour cette renaissance de Picasso : son séjour à Gósol, sa première approche des doutes de Cézanne, et la puissance créatrice que l'amitié eut sur lui. Ces trois raisons étroitement liées seront présentées dans trois sections et sphères de recherche différentes.
[1] Voir Gertrude Stein, The Autobiography of Alice B. Toklas, dans Writings, Vol.I: 1903–1932 (New York: The Library of America, 1998), p. 653–913, texte p.713. Voir aussi Gertrude Stein, Picasso, dans Writings, Vol.II: 1932-1946 (New York: The Library of America, 1998), pp. 497-533, en particulier p. 502, p. 509–513. En lisant ces textes, le premier écrit en 1932 et le second en 1938, il faut tenir compte du fait qu'à cette époque, Gertrude Stein et Picasso s'étaient éloignés et qu’elle s’était liée d’amitié avec Bernard Faÿ, que l'écrivain dérivait vers le pétainisme, et que les textes mentionnés reflètent, selon moi, la tentative de récupérer quelque chose de perdu. Sur la dérive fasciste de Stein, voir notamment l'ouvrage dévastateur de Barbara Will : Collaboration improbable. Gertrude Stein, Bernard Faÿ and the Vichy Dilemma (New York: Columbia University Press, 2012). Voir aussi les ouvrages suivants, plus condescendants que celui de Will : Edward M. Burns and Ulla E. Dido, The letters of Gertrude Stein and Thorton Wilder (New Haven and London: Yale University Press, 1996), p. 405; Luci Daniel, Gertrude Stein (London: Reaktion Books, 2009); Laurence Madelaine, Gertrude Stein, Pablo Picasso. Correspondance (Paris: Gallimard, 2005), p. 349–351; Nadine Satiat, Gertrude Stein (Paris: Flammarion, 2010), p. 849–976; Diana Souhami, Gertrude & Alice (London – New York: I. B. Tauris, 1991, réimprimé en 2010), p. 221–40. Pour une interprétation du Portrait de Gertrude Stein analysant l’identité sexuelle dans la relation entre le peintre et le modèle, voir Robert Lubar, « Unmasking Pablo’s Gertrude: Queer Desire and the Subject of Portraiture », The Art Bulletin 79 (1997): p. 57–84. Sur l’amitié entre Picasso et Gertrude, voir Hélène Klein, « Gertrude Stein and Pablo Picasso : In their Own Words », dans le catalogue The Steins Collect. Matisse, Picasso, and the Parisian Avant-Garde. (New Haven and London: San Francisco Museum of Modern Art in Association with Yale University Press, 2011) p. 243–57. Pour une approche exhaustive et hagiographique de la biographie de Stein, voir Wanda A. Corn et Tirza True Latimer, Seeing Gertrude Stein. Five Stories. (San Francisco: Contemporary Jewish Museum; Washington: National Portrait Gallery (Smithsonian Institution); Berkeley, Los Angeles, London: UC Press, 2011.
[2] Gertrude Stein parle d’environ quatre-vingt-dix séances. Comme elle l'a écrit, « En 1906, Picasso a travaillé sur mon portrait pendant tout l'hiver ». (Stein, Picasso, p. 512). Voir John Richardson (avec la collboration de Marilyn McCully), A life of Picasso. Vol. I: 1881-1906 (New York: Random House, 1992), chapitre 26, p. 404; Les chercheurs considèrent toutefois que ce nombre est exagéré. Voir Gary Tinterow and Susan Alyson Stein (Eds) Catalogue, Picasso in the Metropolitan Museum of Art (New Haven et Londres, 2010), p. 103. Collaboration improbable. Gertrude Stein, Bernard Faÿ and the Vichy Dilemma (New York: Columbia University Press, 2012). Voir aussi les ouvrages suivants, plus condescendants que celui de Will : Edward M. Burns and Ulla E. Dido, The letters of Gertrude Stein and Thorton Wilder (New Haven and London: Yale University Press, 1996), p. 405; Luci Daniel, Gertrude Stein (London: Reaktion Books, 2009); Laurence Madelaine, Gertrude Stein, Pablo Picasso. Correspondance (Paris: Gallimard, 2005), p. 349–351; Nadine Satiat, Gertrude Stein (Paris: Flammarion, 2010), p. 849–976; Diana Souhami, Gertrude & Alice (London – New York: I. B. Tauris, 1991, réimprimé en 2010), p. 221–40. Pour une interprétation du Portrait de Gertrude Stein analysant l’identité sexuelle dans la relation entre le peintre et le modèle, voir Robert Lubar, « Unmasking Pablo’s Gertrude: Queer Desire and the Subject of Portraiture », The Art Bulletin 79 (1997): p. 57–84. Sur l’amitié entre Picasso et Gertrude, voir Hélène Klein, « Gertrude Stein and Pablo Picasso : In their Own Words », dans le catalogue The Steins Collect. Matisse, Picasso, and the Parisian Avant-Garde. (New Haven and London: San Francisco Museum of Modern Art in Association with Yale University Press, 2011) p. 243–57. Pour une approche exhaustive et hagiographique de la biographie de Stein, voir Wanda A. Corn et Tirza True Latimer, Seeing Gertrude Stein. Five Stories. (San Francisco: Contemporary Jewish Museum; Washington: National Portrait Gallery (Smithsonian Institution); Berkeley, Los Angeles, London: UC Press, 2011.

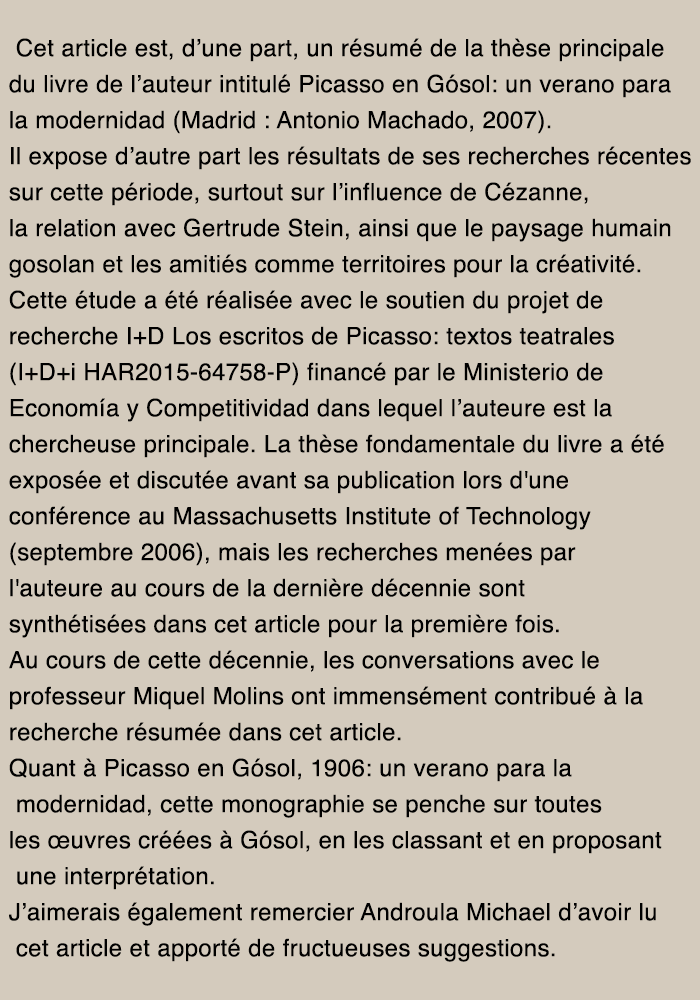




 Sommaire
Sommaire