Première galerie, rue Vignon, la découverte du cubisme
Très cultivé, curieux, observateur affûté, sûr de ses goûts, ne connaissant strictement rien au milieu de l’art, il embrasse la carrière avec l’insouciance de la jeunesse et le soutien de sa famille pour cette démarche singulière, bien loin des traditions patriarcales. Il ouvre sa galerie en 1907, minuscule local sis au 28 rue Vignon, dans le VIIIe arrondissement de la capitale. Son nom restera éternellement lié au cubisme qu’il a contribué à faire connaître. Il est d’ailleurs le seul marchand de sa génération qui ait réussi à associer son nom de manière irréversible à ce moment décisif de l’art moderne.[1]
Dès son arrivée à Paris, Kahnweiler s’enquiert des artistes de la jeune génération et se rend au Salon des Indépendants, où il achète ou repère Derain, Vlaminck et Braque. La première rencontre avec Picasso a lieu la même année. Le peintre était venu regarder par deux fois, seul, puis avec Ambroise Vollard, ce que proposait ce nouveau galeriste, mais sans se présenter à lui. Ce n’est que lorsque Kahnweiler vient visiter l’atelier du Bateau-lavoir que les deux hommes font vraiment connaissance. Le galeriste découvre les Demoiselles d’Avignon sur lequel le peintre travaille. C’est un choc artistique pour le jeune Allemand, ébranlé à la vue de ce tableau qui n’a pas son pareil, et qui marquera durablement ses choix et ses engagements. Cette rencontre débouchera sur une relation professionnelle suivie trois ans plus tard. À l’époque, Ambroise Vollard officie en tant que marchand pour le jeune Picasso. Celui-ci réalise le portrait de Kahnweiler en 1910, ce qui montre qu’il existe déjà une certaine intimité entre eux.
La galerie devient un lieu de rencontres pour la jeune génération de poètes et d’artistes et de façon générale, pour les soutiens de la jeune peinture[2].
Kahnweiler pressent que quelque chose se passe dans l’acte de création chez ses jeunes artistes. Il comprend qu’il assiste à une « révolution picturale » qui se joue là, ce cubisme porté ensuite par Braque, Fernand Léger, et Juan Gris. Ils déconstruisent l'espace, les objets et les corps en formes géométriques, s'affranchissent du réel et de la perspective. Selon André Salmon, c ’est à partir de 1906 que Picasso explore d’autres formes d’expression qui l’amèneront vers ce qui fut dénommé alors « le cubisme » : rupture avec la ressemblance, décomposition, puis recomposition de la forme, fragmentation des volumes, discontinuité des traits, avant, selon Pierre Daix, « d’en inventer les architectures structurales. Son cubisme ainsi défini inclut par la suite ses papiers collés, ses assemblages, sa transmutation en cubisme synthétique, la reconquête du portrait après 1914. »[3] Concernant Picasso, « son » cubisme est plutôt le fruit de recherches engagées avec Georges Braque qui l’ont conduit à formuler autrement son expression artistique. Pour Kahnweiler, le cubisme de Picasso est bien cette peinture lyrique [qui] est l’expression de la vie spirituelle de notre époque ».[4] Braque et Picasso ont entrepris une collaboration étroite à l’été 1908, fruit d’un cheminement parallèle des deux artistes autour de recherches communes et d’interrogations similaires. Leur complicité fusionnelle et leurs échanges ne cessèrent plus jusqu’à ce que la guerre les sépare. Ils se voient chaque jour, ou se rejoignent lorsqu’ils séjournent dans le sud de la France, comparent, discutent des disquisitions réalisées, du travail accompli, de leurs interrogations respectives.
[1] Pierre Assouline, L’Homme de l’art. D.-H. Kahnweiler 1884-1979, Éditions Balland, 1988 ; collection folio, Éditions Gallimard, 1990
[2] Voir l’article sur Daniel-Henry Kahnweiler pages 20à 23, publié dans le hors-série publié en 2020 des Cahiers du musée national d’Art moderne.
[3] Pierre Daix, dictionnaire Picasso, entrée « cubisme » page 226, éditions Robert Laffont, 1995.
[4] Kahnweiler, Weg zum Kubismus, écrit en 1914, cité par Pierre Daix, op.cit page 228.
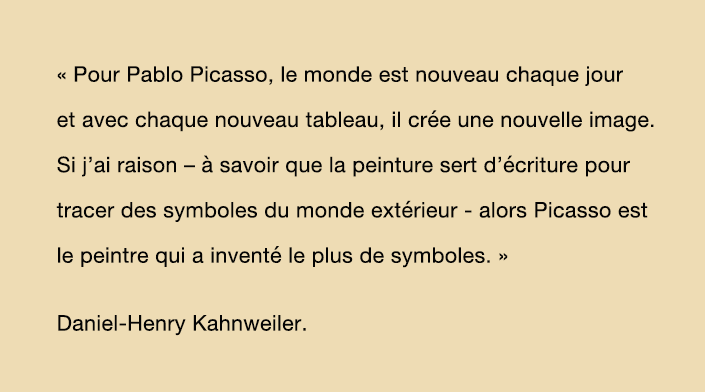
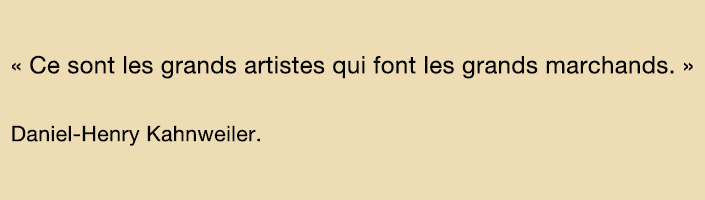





 Sommaire
Sommaire