Une dation comme l’évocation précise du processus créateur de l’artiste.
Le Musée National Picasso de Paris est l’un des membres de cette commission et il est donc opportun de rappeler les circonstances et les décisions qui ont permis l’acquisition d’un ensemble d’œuvres à l’origine, à Paris, du musée national Picasso. Par sa qualité́, son ampleur comme par la diversité́ des domaines artistiques représentés, la collection du Musée national Picasso-Paris est la seule collection publique au monde qui permette une traversée de tout l’œuvre peint, sculpté, gravé et dessiné de Picasso, comme l’évocation précise du processus créateur de l’artiste. Elle a été créée grâce à la dation en paiement des droits de succession consentis à l’État par les héritiers de Pablo Picasso en 1979.
La loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 « tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national », voulue par André Malraux, avait pour objet de permettre la mise en œuvre de nouveaux moyens pour accroître les collections des musées et des bibliothèques, pour maintenir en France les œuvres d'art d'une haute valeur artistique ou historique et pour sauvegarder, au bénéfice du public qui les visite, le caractère de certaines demeures. Elle est parfois nommée, à tort, loi sur les dations alors qu’elle visait à faciliter également d’autres dispositifs, comme les donations. Son article 2 stipule que « tout héritier, donataire ou légataire peut acquitter les droits de succession par la remise d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique. » Le décret d’application a été publié presque deux ans plus tard, c’est le décret n° 70-1046 du 10 novembre 1970 qui crée une commission qui « émet un avis tant sur l’intérêt artistique ou historique que sur la valeur du bien offert ». La commission elle-même ne sera constituée qu’en octobre 1971.
La constitution pour les musées d’un ensemble d’œuvres du peintre n’allait pas de soi, tant les relations de Picasso avec l’administration culturelle furent difficiles. Selon l’historien Pierre Schneider, Picasso avait pourtant émis le souhait d’une donation conséquente : « En 1966, alors qu’une ample rétrospective était consacrée à Picasso au Grand-Palais, André Malraux ne fit rien pour empêcher son expulsion de l’atelier de la rue des Grands-Augustins. Furieux, le peintre refusa la Légion d’honneur, bouda l’exposition, et renonça à la donation considérable qu’il s’apprêtait à faire. »[1]
On savait pourtant Picasso plutôt généreux : à Paris, avec le don de 10 œuvres majeures offertes au Musée national d’art moderne dirigé par Jean Cassou, et en régions. Le musée de Grenoble, seul musée français à lui avoir acheté une œuvre dans l’entre-deux-guerres, grâce au talent de son conservateur Andry-Farcy recevra un don de l’artiste (Femme lisant, 1920). Après la guerre, à la suite de son séjour en 1946, il laisse à la ville d'Antibes 23 peintures et 44 dessins et enrichit cette collection en 1948 par un don de 78 céramiques réalisées à l'atelier Madoura. En 1949, la sculpture l’Homme au mouton est offerte par Picasso à la ville de Vallauris et installée dans une chapelle inutilisée : l’idée naît, alors, de créer une œuvre, la Guerre et la Paix, dont les 18 panneaux sont achevés en décembre 1952.
Une « dation » fut donc une chance aussi spectaculaire qu’inespérée pour faire entrer des œuvres du peintre dans les collections nationales.
[1] Pierre Schneider, « Picasso », L’Express du 29 septembre au 5 octobre 1979, page 140.
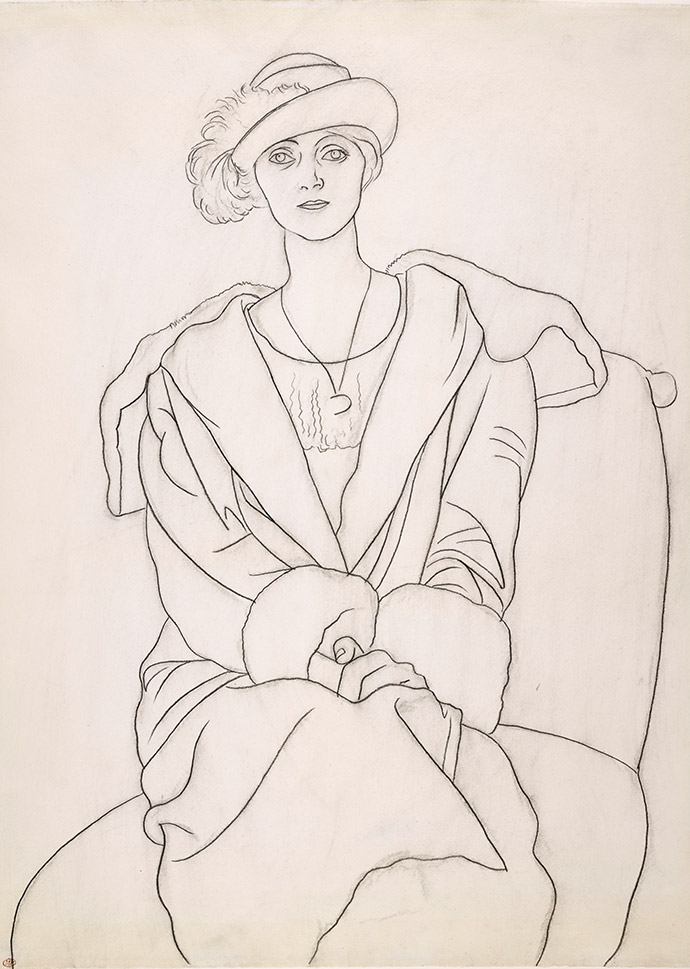

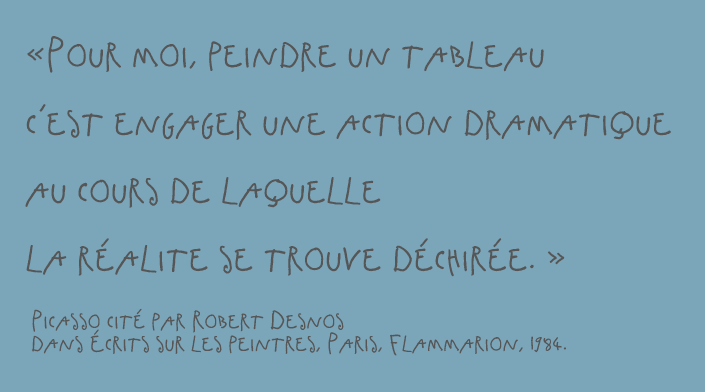




 Sommaire
Sommaire